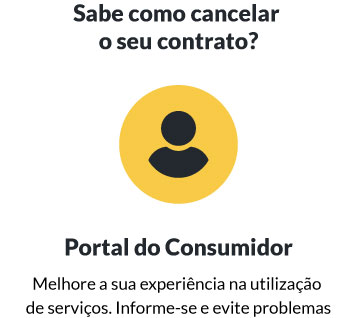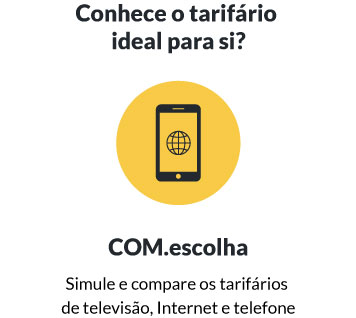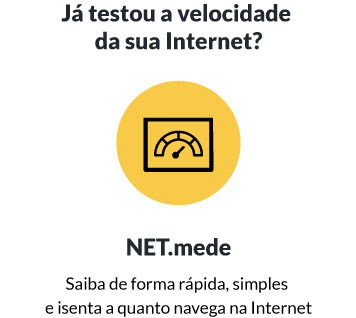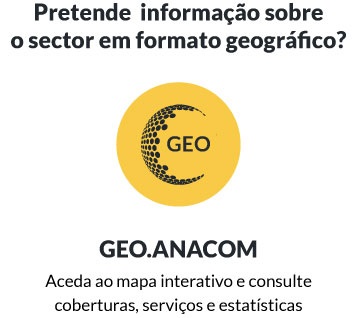Conclusions du Groupe de Travail 1
Aspects technologiques et de marché du DVB-T
Le goupe de travail 1 a eu la chance de pouvoir écouter sept intervenants excellents qui ont traité de tous les aspects, non seulement techniques mais aussi de mise sur le marché et de commercialisation. Il est très vite apparu, comme l'a fait remarqué le président, que la technologie n'était pas le problème. À beaucoup d'égards, d'autres sujets délicats ont semblé plus évidents, et on peut penser qu'ils sont beaucoup plus importants. Ces sujets seront abordés, non dans un ordre particulier de préférence ou d'importance, mais plutôt au fur et à mesure qu'ils apparaissent dans la discussion.
En tout premier lieu, un élément clé est clairement ressorti de la plupart des présentations : règles de diversité, il n'y a pas deux marchés qui se ressemblent.
1. Service universel
Il est freiné par le fait que les "set-top boxes" ne sont pas standardisées. Le service universel est cher. La DVB-T peut aider à réduire les coûts de distribution de 50 à 70% par rapport aux chaînes analogiques.
2. Réception (fixe, portable, mobile)
Dans certains exemples, la réception portable peut procurer la seule opportunité d'introduction de la DVB-T, comme en Allemagne où seulement 10 % des foyers ont une réception terrestre (54 % par cable, 36 % par satellite). La réception portable sans antenne devrait être universelle. La réception portable est enfin essentielle aux nouveaux services et à l'accès à Internet car elle procure des recettes supplémentaires bien nécessaires.
3. Utilisation du spectre
Une longue transition ne mènera pas à l'utilisation la plus efficace du spectre, et celui-ci ne sera pas accessible d'une manière équitable. Il est malgré tout apparu évident que l'esprit de collaboration se développe entre les opérateurs publics et privés. Ce sont traditionnellement les opérateurs publics les mieux préparés pour la diffusion terrestre car ils contrôlent déjà le spectre. ARD et ZDF, par exemple, utilisent aujourd'hui près de 80 % du spectre. Ils accepteraient, sous certaines conditions, de voir ce pourcentage descendre à 50 %.
4. Standards (set-top box et MHP)
La standardisation des "set-top boxes" qui peuvent être utilisées n'importe où en Europe est considérée comme essentielle. Celle de l'API, qui a été plutôt lent sur la DVB, est également essentielle. Toutefois, un standard est sur le point d'apparaître avec le travail sur le MHP, dominé par l'Europe et pour lequel d'autres pays, comme le Japon, ont exprimé leur intérêt. Une seconde activité (ATVEF) est en bonne place pour faire concurrence au MHP, avec tout ce que cela peut entraîner. En ce qui concerne les standards, comme le disait l'un des participants : "si vous êtes au milieu, il est important que ceux qui vous entourent soient d'accord sur quelquechose (quelquefois n'importe quoi). Cela est très vrai en Europe, où tout le monde peut dire qu'il est au milieu".
5. EPG
Peu de choses ont été dites à propos des EPG. Une chose est certaine : il existe différents systèmes opérateurs valables (Open TV, Iconic, etc...) qui demandent tous des hardwares différents.
6. Prix
Le prix des "set-top boxes" est certainement un problème. Des études (en Allemagne) ont montré qu'un tiers de la population est prête à payer pour une "set-top box" TV non codée. Le pourcentage se réduit à 10 % pour les gens prêts à payer de 125 à 250 euros, à 1 % pour de 250 à 375 euros, et à presque rien pour plus de 375 euros. Au Royaume-Uni, le cas de figure le plus acceptable tourne autour de 70 euros. Il faudrait ajouter à cela que certains peuvent avoir besoin d'autant de "set-top boxes" qu'ils ont de postes de télévision. Une solution pourrait alors être la mise sur le marché de postes de télévision numérique intégrés, qui a déjà commencé, et la combinaison avec la plateforme multimédia des particuliers. En général, la différence entre les postes analogiques et les postes numériques est approximativement de 20 %, écart dont on espère qu'il baissera bientôt jusqu'à 10 %.
7. Timing de la fermeture de la télévision analogique
La transition va durer plusieurs années, certains pensent plus de 15 ans. Comme les systèmes digitales ne vont pas disparaître de bonne grâce, un planning prudent est nécessaire afin d'éviter toute interférence. À cette fin, une diffusion simultanée dans les deux systèmes devrait durer le moins de temps possible, et les transmetteurs analogues devraient être mis hors service progressivement. Il y aura probablement, au début, une couverture insuffisante pour la réception portable.
Très peu de pays ont décidé d'une date et c'est peut-être mieux ainsi, étant donné les différents points de vue sur la longueur de la période de transition et l'impact qu'elle peut avoir sur la qualité du service fourni. La fermeture de la télévision analogique est en outre délicate en terme d'accueil par le marché. Elle peut cependant être mise à profit pour financer la venue de la télévision numérique en libérant des fréquences qui peuvent être utilisées par d'autres services.
Tout dépend, bien sûr, de ce qui se passera entre-temps, c'est-à-dire qu'une autre technologie peut encore voir le jour.
Un fait avéré sur plusieurs marchés, et qui a été observé lors de l'introduction d'autres services terrestres, est le caractère essentiel de la collaboration initiale entre les opérateurs publics et privés afin de de ne pas fragmenter trop tôt un marché déjà fragile.
Enfin, il faut garder à l'esprit que ce ne sont pas les "set-top boxes" que les gens regardent. Ils regardent les contenus. Si les services doivent fleurir, ce ne sera qu'en faisant des contenus attractifs.