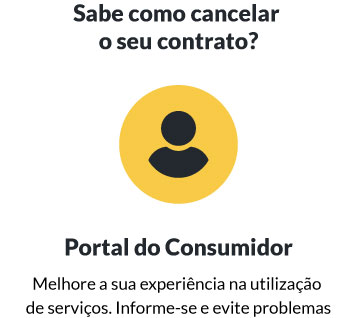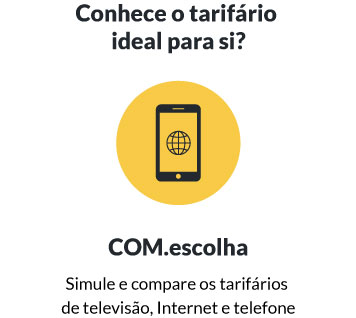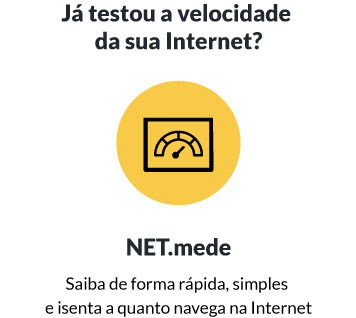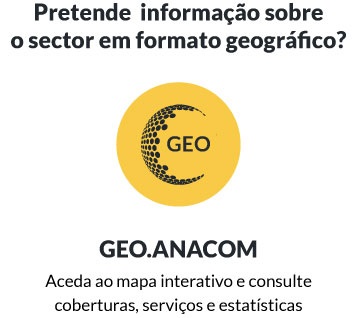Conclusions du Groupe de Travail 2
Modèles de mise en oeuvre et Objectifs de l'intérêt public
1. La migration vers le numérique terrestre est inéluctable
Personne ne s'est interrogé sur la question de savoir s'il fallait ou s'il ne fallait pas s'engager dans la numérisation de la diffusion terrestre. Il y a des pays, y compris en France, où, en particulier, les concurrents de la diffusion numérique terrestre, c'est à dire les opérateurs du câble ou les opérateurs du satellite, essaient d'expliquer aux décideurs politiques qu'il ne faut pas se presser, qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il ne faut pas y aller. Mais à aucun moment la question ne s'est posée de savoir s'il faut y aller, mais, seulement, comment?
Si la numérisation est incontournable, des interrogations existent encore sur les conditions du succès de l'opération qu'il faut analyser en tenant compte les résultats des expériences des pays pionniers.
Il est sûr que le numérique ne va pas révolutionner à court terme tout le paysage audiovisuel. Mais le passage du mode analogique au mode numérique pour la diffusion de la télévision est en quelque sorte une nouvelle étape, probablement la dernière et de grande importance, dans le long processus d'application progressive des technologies numériques à l'ensemble de la chaine de l'audiovisuel.
2. Avantages de la migration vers le numérique
Les avantages qui resultent du passage vers le numérique interessent, à la fois, les télespectateurs, les opérateurs audiovisuels et la collectivité nationale et européenne.
Pour les télespectateurs, la numérisation de la diffusion terrestre devrait apporter à tous ceux qui ne sont pas raccordés au câble ou au satellite, donc la majorité des télespectateurs des pays européens, une offre élargie de programmes et de services, accessible facilement, en principe sans modification des antennes, à la seule condition de s'équiper en récepteurs ou en décodeurs.
Un autre des avantages c'est que cette offre pourrait être démultipliée sur le plan local. Trois qualités complémentaires qu'apporte le numérique sont la portabilité, la mobilité et aussi l'interactivité. Bien que l'interactivité soit naturellement davantage favorisé par le support du câble le numérique permet, tout de même, d'introduire des éléments d'interactivité: la télévision numérique terrestre, pour les télespectateurs, fait en quelque sorte partie intégrale d'une politique globale, permettant l'accès du plus grand nombre à la société de l'information. C'est donc lá un moyen de combler l'écart qui se développe entre les nouveaux riches et les nouveaux pauvres au regard de la société de l'information.
Pour les entreprises de l'audiovisuel, la numérisation devrait entraîner, surtout à la fin de la diffusion analogique, une forte réduction des coûts de la diffusion par rapport aux coûts de l'analogique, même si on est conscient que le coût de la diffusion est plus élevé pour le numérique terrestre que pour le satellite.
De nouveaux marchés, également, sont probablement ouverts pour la production d'équipements de réception et il y a un marché énorme pour l'industrie de l'electronique grand public. Enfin, la diffusion terrestre devrait sans doute être un élément d'une politique de soutien à la production, en particulier en ce que concerne la production audiovisuelle de contenu européen.
Le passage au numérique rend enfin possible une gestion plus économique du spectre des fréquences, en permettant à terme de mieux utiliser les fréquences disponibles, une fois fermé le service analogique, soit pour augmenter le spectre attribué à la télévision numérique, soit pour des nouveaux usages.
3. Les incertitudes
Un certain nombre d'éléments d'incertitude sont apparus dans la discussion: la télévision numérique va-t-elle intervenir en complément ou en concurrence frontale avec le satellite ou le câble? Il est clair que l'arrivée potentielle d'une nouvelle offre numérique supplémentaire représente un risque de déstabilisation des économies du satellite et du câble.
Le deuxième élément d'incertitude porte sur le rythme d'implantation du système numérique. Cette question est liée aux prix des recepteurs, à l'attractivité des nouveaux programmes, à l'élasticité du marché de la publicité et à la capacité du spectre en matière de couverture territoriale.
Le troisième élément d'incertitude c'est le fait que, pendant cette période de migration, des évolutions téchniques importantes peuvent intervenir, qui entraîneront des conséquences sur la nature et sur l'économie des services de télévision, en particulier l'accès d'Internet.
Une nouvelle étape dans le changement du mode de consommation pourrait intervenir avec le passage de la consommation de la télévision face à un écran de télévision et la consommation encore plus individualisée, en particulier par les jeunes generations devant un écran d'ordinateur. Quelles seront les conséquences de ces phénomènes? C'est le problème plus général de la convergence qui, avec le développement de la société d'information, va permettre l'accès de programmes sur des récepteurs aussi différents que le poste de télévision, le personal computer ou le téléphone cellulaire GSM, et plus tard l'UMTS.
Qu'en résultera t-il sur le rôle de la télévision? Ce sont des incertitudes qu'il est important de prendre en compte.
4. Modèles de mise-en-oeuvre
Les débats ont permis de conclure qu'il n'y a pas de modèle unique pour la mise-en-oeuvre de la télévision numérique terrestre.
L'expérience anglaise est incontestablement la plus avancée. Le cadre juridique de la numérisation remonte à 96, le lancement commercial est intervenu en Novembre 98. La particularité du Royaumme Uni c'est que le monde de la télévision numérique de terre est en concurrence seulement avec le bouquet de télévision par satellite commercialisé par BskyB, dont la numérisation d'ailleurs a été accélérée, et en retour "On Digital", opérateur commercial de la télévision numérique de terre, a été amenée à subventionner les terminaux de réception, soit sous forme de remise soit sous forme de mise à la disposition de décodeurs pour les abonnés. C'est la particularité la plus importante du système britannique, c'est probablement aussi un des facteurs majeurs de son succès. L'autre facteur spécifique c'est l'engagement de la BBC dans le développement de progammes nouveaux.
En sens inverse, il y a l'expérience suédoise, un système fondé sur des principes différents, à savoir le fait qu'on attribue la capacité par service et progressivement. On ne prévoit pas, au départ en tout cas, la location de décodeurs. Il en est résulté un échec qu'il a fallu corriger. Par consequent, il y a eu un changement de stratégie, les autorités ayant demandé à Senda de louer des décodeurs et un nouvel appel à candidature étant lancé en Juillet 1999 pour un quatrième multiplex.
L'Allemagne présente un cas totalement à part, avec une particularité: environ 10% seulement des foyers utilisent la réception terrestre de la télévision, en raison du développement considérable du câble et du satellite, qui offrent déjà vingt cinq programmes en "clair". Le point de départ de l'Allemagne est donc complètement différent du point de départ d'autres pays, comme la France.
Les exemples de l'Espagne et de l'Italie sont aussi illustratives de la diversité de situations qu'existent dans l'Europe.
Il y a donc une profusion de modèles dont aucun ne ressemble à l'autre.
Le document de travail de la Conférence rappellait les trois familles de scénarios, avec un modèle 1 complètement centralisé avec une plateforme numérique unique, un modéle 2 de sens inverse avec une multiplication d'ópérateurs par plateformes. Le premier modèle étant fondé sur l'idée de la masse critique maximale pour faire démarrer l'opération, le modèle 2 fondé au contraire sur le principe de la libre concurrence, et entre les deux modèles, un modèle 3 qui essaie de concilier libre concurrence et masse critque. Le modéle 3 semble assez bon, mais il est très difficile de classer chacun des pays à l'intérieur de ces trois modèles.
5. Conditions de succés de la migration vers le numérique
Les conditions de succès peuvent être systematisées de la façon suivante:
Première condition - la migration doit se faire sur la durée, cette durée étant plus ou moins longue: plus elle sera rapide, tout en étant progressive, mieux cela vaudra. Mais il faut un scénario de transition bien préparé, bien planifié, et qui doit se faire dans un esprit à la fois de complémentarité avec les autres supports, pour ne pas décourager le satellite et le câble, mais en même temps qui permet de maximiser les chances du nouveau support.
Deuxième condition - avec l'élargissement de l'offre des programmes, la création d'une masse critique de télespectateurs acceptant la migration vers le numérique est une condition essentielle du succès de l'opération. L'important c'est d'attirer les télespectateurs: c'est le contenu qui permet de le faire. Il reste un paradoxe, avec, d'un côté, la nécessité de programmes en "clair". Pour créer cette masse critique, et, d'un autre côté, le fait que le lancement de l'opération ne réussit souvent qu'avec des programmes cryptés, et la location de décodeurs à bas prix.
En ce qui concerne les programmes qui seront mis à la disposition du public, un accord général est apparu sur la nécessité d'une diffusion intégrale et simultanée en numérique des chaines actuellement diffusées en analogique ("simulcast"). Le "simulcast" est indispensable pour permettre aux télespectateurs qui font l'effort d'acquérir un équipement numérique d'avoir accès, au moins, à leurs programmes habituels. Mais ce "simulcast" va créer des sur-coûts pour les diffuseurs actuels.
Au-delà du "simulcast", un large consensus existe sur le role essentiel des programmes. La télévison aura ici l'occasion de montrer sa capacité de souplesse dans la Ordre du Jour de la grille soit par des programmes de base déclinés (ce qu'on appelle les programmes décalés). Soit de nouvelles chaines généralistes en clair, soit des chaines thématiques en clair, avec toutefois une place pour des programmes cryptés.
La deuxième série de conditions du succès inclut donc l'élargissement de la gamme des programmes.
Troisième condition - le choix des conditions d'attribution des fréquences doit être approprié. Est-ce qu'on les attribue par service ou par multiplex? Ceux qui estiment qu'il faut d'abord créer les conditions économiques du succès - les opérateurs en particulier - disent qu'il faut les attribuer par multiplexe. Ceux qui insistent sur le pluralisme - les autorités de regulation - disent qu'il faut les attribuer par service. Une synthèse peut être recherchée avec l'attribution, par canal mais peuvant comporter des offres de programmes grupés.
Quatrième condition - une planification détaillée des fréquences est essentielle. Cette planification des fréquences est quelque chose de très compliqué et il faut le faire soigneusement sur le terrain.
Enfin, il faut avoir une stratégie raisonnable en ce qui concerne l'arrêt à terme de la diffusion numérique.
Dernière question - est-ce qu'il y existe un modèle global européen pour cette importante opération? La diversité des situations est considérable. Est-ce qu'il faut créer un certain degré de coordination? Et dans quel domaine? Est-ce qu'il faut prévoir une date commune pour l'ensemble de l'Union Européenne? Ce n'est pas evident, compte tenu de l'état d'avancement inégal des projets dans les différents pays. Probablement, c'est la priorité au contenu qui devrait être un des domaines majeurs de préoccupation de l'Union Européenne, parce-que c'est par les contenus que l'on affirme l'identité culturelle européenne.
Mais la convergence n'est pas l'uniformité des contenus, c'est au contraire la possibilité de diffuser ces contenus sur des plateformes différenciées. Il y a sans doute divergence sur les moyens de favoriser cette identité culturelle, mais un desaccord sur les moyens n'exclue pas qu'il faille se mettre ensemble pour essayer de réfléchir sur la manière de mettre en oeuvre l'objectif commun d'enrichissement des contenus européens.